News

R&T 79 : La santé humaine passe par celle des écosystèmes
Médecin et épidémiologiste, Camille Besombes nous encourage à élargir notre approche de la santé à l’environnement. La préservation et la réparation des écosystèmes est une nécessité pour freiner l’émergence des maladies infectieuses.
Une maladie est dite émergente quand elle est causée par l’apparition d’un nouvel agent infectieux mais aussi quand une maladie déjà connue sévit dans un nouvel endroit ou touche une nouvelle population. « C’est un phénomène qui a toujours existé mais qui s’accélère, souligne Camille Besombes, médecin spécialiste en maladies infectieuses et tropicales, docteure en épidémiologie et chercheuse à Sciences Po médialab . Il peut s’agir de zoonoses ou de maladies vectorielles transmises par des vecteurs comme les tiques ou les moustiques : de maladies connues pour toucher une espèce et qui en atteignant une autre, de maladies qui arrivent dans une nouvelle région du globe. Comme, par exemple, le mpox ou la dengue qui sont désormais présentes dans beaucoup de pays au-delà de leur aire de répartition initiale sont des maladies émergentes ».
La prévention des maladies émergentes est un véritable enjeu d’habitabilité et de santé publique, qui nécessite de comprendre dans quels environnements sociaux et écologiques, ces maladies émergent. « Cela nécessite de ne plus regarder ces maladies une par une, mais de chercher à faire des liens entre les différentes émergences infectieuses, de déterminer les changements globaux impliqués et les déterminants communs », partage Camille Besombes. Parmi les facteurs d’explication de l’accélération du nombre de maladies émergentes, le premier qui vient à l’esprit est le changement climatique. « En effet, avec la hausse des températures, les zones de présence des vecteurs, comme les tiques et les moustiques, vont s’agrandir et avec elles, l’aire géographique dans laquelle une maladie va se propager », confirme Camille Besombes. On pense aussi à la globalisation des transports humains et de marchandises, qui peuvent véhiculer des personnes malades et vecteurs.
Avoir une approche globale santé et environnement
Mais le changement climatique n’est pas le facteur le plus important : les changements d’usage des terres ou modifications de l’environnement (déforestation pour la conversion en agriculture intensive) sont un facteur primordial, qui déstabilisent les écosystèmes et les chaînes alimentaires (réseaux trophiques). Quand les écosystèmes sont perturbés, la biodiversité s’appauvrit, ce qui perturbe les cycles naturels d’autorégulation qui limitent les risques d’émergence et de propagation de maladies. Camille Besombes donne en exemple des écosystèmes où les chaînes alimentaires encore à peu près complètes et fonctionnelles. Ainsi, en Slovaquie, dans des zones où des loups sont encore en densité suffisante, il n’y pas de cas de peste porcine africaine. Les prédateurs assurent une régulation en éliminant rapidement les individus malades et les cadavres, alors que les zones sans loup sont fortement touchées par l’épizootie.
Les changements d’usage des terres, comme la déforestation, entraînent la disparition de certaines espèces, par la perte de leur habitat naturel ou de leurs ressources alimentaires, laissant d’autres espèces opportunistes proliférer. La déforestation favorise également le rapprochement de certaines espèces des lieux de vie d’humains, augmentant le risque de contact inter-espèces et la transmission de maladies. « Les modifications qu’on fait subir aux écosystèmes engendre un cycle délétère », constate Camille Besombes. Pour autant, est-ce possible d’arrêter, ou au moins de freiner, ces changements néfastes ? «La crise du Covid a montré que c’était possible, au prix d’une prise de conscience et d’efforts collectifs. Mais depuis que cet épisode s’est refermé, nous semblons être revenus à un déni collectif »

Réfléchir conjointement santé et environnement
Face à ces maladies émergentes, Camille Besombes souligne l’importance de la prévention. « Quand une maladie apparaît, se transforme en épidémie, on organise des quarantaines pour tenter de la juguler, on met au point des vaccins ou des médicaments. Mais c’est compliqué et coûteux de lutter contre une nouvelle maladie de façon réactive, rappelle la médecin. Prévenir une pandémie coûte moins cher que de guérir ». Pour être pleinement efficace, la prévention doit être large, notamment en intégrant les aspects sociaux et environnementaux. Il est nécessaire de réfléchir ensemble à la santé et à l'environnement. « L’approche One Health doit favoriser des socio-écosystèmes équilibrés, robustes et résilients », argumente Camille Besombes, qui en appelle à une prise de conscience sociétale et étatique que préserver la santé publique passe par la préservation de l’environnement. « Il faut tendre vers un modèle « One Eco-Health », car il est nécessaire, non seulement d’avoir une gestion commune de la santé animale et humaine, via les démarches One Health, mais aussi de réinsérer ces relations au sein de la santé des écosystèmes, de la santé environnementale de nos territoires, pour retrouver de bons fonctionnements des écosystèmes ». Ce qui appelle des changements des pratiques, des usages et des valeurs, à une nouvelle façon d’habiter la Terre. « C’est exigeant, reconnaît Camille Besombes. Mais ces changements transformateurs sont nécessaires pour tenter d’échapper à l’ère des pandémies (mots de l’IPBES*). Cela passe par des politiques volontaristes, tout en tenant compte des spécificités locales et territoriales et potentiellement par des réflexions autour d’une approche éthique One health».
* IPBES : Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques
Agir dans les territoires
En parallèle de l’échelle internationale et étatique, c’est aussi à l’échelle des territoires qu’il faut agir. « Pour préserver notre santé, tous les acteurs et actrices du territoire doivent prendre conscience des impacts sanitaires de l’aménagement. En effet, les aménagements du territoire (coupes forestières, construction, artificialisation, pratiques agricoles), les politiques de gestion des animaux considérés comme « nuisibles » et ESOD (espèces susceptibles d’occasionner des dégats) sont des facteurs qui peuvent freiner ou accélérer l’émergence de maladies infectieuses zoonotiques ou vectorielles, explique Camille Besombes. Les décisions d’acteurs individuels ou à l’échelle d’une commune ou d’un département, d’une préfecture peuvent déjà faire la différence et ont un rôle à jouer en termes de prévention ».
Au niveau agricole, des actions peuvent favoriser la biodiversité comme le fait de favoriser la polyculture-élevage, des zones de jachère ou de friches, des mares, la préservation des habitats des espèces sauvages, la création de corridors verts. « Tout ce qui peut permettre aux écosystèmes de retrouver leurs fonctions. Atténuer l’impact des activités humaines agit en faveur de la santé commune » encourage Camille Besombes. A l’échelle des territoires, des actions collectives peuvent être mises en place. « Dans la Drôme, illustre Camille Besombes, le réseau des fermes paysannes et sauvages promeut une agriculture extensive et diversifiée. Par l’acquisition de fermes, ses membres cherchent aussi à recréer des corridors écologiques pour favoriser la circulation des espèces sauvages. Ce maillage territorial concourt à faire revenir la biodiversité ».














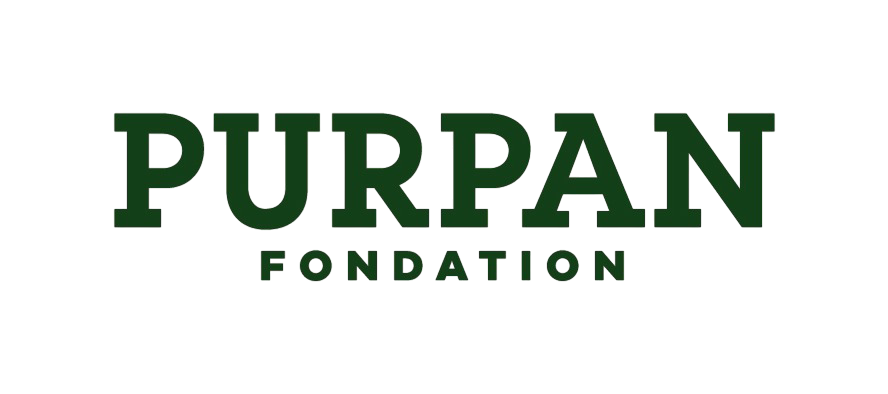
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.