News

R&T78 : Berry Graines, l’aventure du Quinoa Made In France
Pourrais-tu nous présenter et nous parler de Berry Graines, mais également de Damien et toi?
C’est sur les bancs de l’École d’Ingénieurs de PURPAN que Damien et moi nous sommes rencontrés, promo 90. Après quelques années à la Chambre d’Agriculture pour moi et une coopérative agricole pour Damien, il reprend l’exploitation familiale dans le Cher. À l’époque, la ferme reposait sur un modèle classique : blé, orge, colza et un troupeau de vaches à viande. Mais face aux défis climatiques et aux limites de ce schéma, nous voulions innover et trouver une culture d’avenir, rustique et à faible niveau d'intrants.
C’est alors que commence notre aventure avec le quinoa. Après des mois de recherche et des voyages au Pérou et en Europe pour maîtriser cette culture peu répandue en France, nous plantons 5 hectares en 2015, puis 40 en 2016 et 80 en 2017. Nos efforts pour optimiser les étapes post-récolte payent : nous mettons sur le marché un quinoa qui se cuit en 6 minutes, contre 12 à 17 habituellement. Ce produit innovant nous ouvre les portes de nos premiers contrats industriels.
En 2017, nous créons Berry Graines, avec l’ambition de maîtriser toute la chaîne de valeur, de la production à la commercialisation. Aujourd’hui, grâce à un réseau de 50 agriculteurs partenaires, nous cultivons 15 espèces différentes, en bio, HVE et conventionnel. Nos clients vont des industriels aux restaurateurs étoilés, en passant par la GMS et la restauration collective, sans oublier les magasins spécialisés.
Avec Berry Graines, nous avons fait le pari de la diversité, de la qualité et de la durabilité. Nous semons ce que nous savons vendre, et notre stratégie s’est développée grâce aux rencontres et opportunités.

Vous travaillez avec de grands restaurateurs français. Pouvez-vous nous parler des exigences spécifiques auxquelles vous devez répondre en termes de qualité, de volume et de régularité d’approvisionnement ?
Dès nos débuts avec les industriels du baby food notamment, nous avons intégré des standards élevés de qualité, sécurité et traçabilité. Ces exigences strictes nous ont permis d’être prêts pour différentes demandes. Pour les restaurateurs, l’adaptation principale a été de créer un conditionnement de 2 kg et de revoir nos minimums de commande.
Quelles sont les difficultés rencontrées pour concilier ces attentes avec des pratiques agricoles durables ?
Notre collaboration avec une chaîne de restaurants healthy, présente à Paris et Londres, illustre parfaitement l’évolution des relations entre producteurs et restaurateurs. Cette enseigne, initialement tournée vers un approvisionnement auprès de grossistes, a pris un virage stratégique en repensant sa démarche RSE. Soucieux de valoriser les produits français et le travail en filière, ils ont décidé de se tourner vers nous.
Les échanges ont été fructueux. Là où, auparavant, ils privilégiaient principalement le prix et la disponibilité, ils ont compris l’importance d’adapter leurs attentes à nos réalités de production. De notre côté, nous avons également ajusté certains aspects, notamment en matière de gestion des stocks, pour répondre à leurs contraintes logistiques.
Au fil du temps, ce partenariat est devenu bien plus qu’une simple relation fournisseur-client. Nous avons rencontré leurs équipes, travaillé avec leurs services marketing et communication pour affiner les messages à transmettre aux consommateurs. Nous les avons même accueillis à la ferme pour une journée immersive, mêlant désherbage manuel, repas convivial et discussions sur les enjeux de l’agriculture durable.
La collaboration ne s’arrête pas là : ensemble, nous avons développé de la recherche autour de nouvelles espèces, dont le sorgho, qui est récemment devenu l’ingrédient clé d’une nouvelle recette de leur menu. Aujourd’hui, ce partenariat s’est solidifié, fondé sur la confiance, l’innovation, et un engagement partagé pour des produits de qualité, locaux et durables.
Nous constatons encore que certains acheteurs de grandes entreprises ignorent le calendrier de production des produits qu’ils commandent. Grâce à l'importation, ils peuvent obtenir n'importe quel produit à tout moment, sans se soucier de la saisonnalité, des cycles et des techniques de culture. Cette approche, bien qu'efficace pour répondre à la demande immédiate, déconnecte les entreprises des réalités de la production locale et des rythmes naturels. Un cycle de production complet nécessite près d’un an : des semis à la récolte, en passant par le refroidissement et le tri du grain. Ce rythme naturel, loin de l’immédiateté, demande une planification en amont et une réelle compréhension des réalités agricoles. Une reconnexion entre la terre et ceux qui en dépendent est essentielle, et c’est précisément ce que nous cherchons à rétablir, avec des partenariats durables et respectueux.
La consommation de légumineuses connaît une forte croissance ces dernières années. Comment travaillez-vous à promouvoir les légumineuses comme élément clé de l'alimentation durable, et quel rôle pensez-vous qu’elles jouent dans le développement d’une résilience alimentaire ?
En France, le décalage entre la communication sur les légumineuses et leur production est frappant. Le défi aujourd’hui n’est pas tant de convaincre d’en manger, mais bien de les produire. En 2023, selon Terres Inovia, la surface dédiée aux lentilles ne couvrait que 28 700 hectares, alors que nous importons encore 60 % des lentilles consommées. En 2022-2023, malgré nos 4 895 tonnes exportées, nous avons importé 39 914 tonnes, principalement du Canada, dont le catalogue variétal est bien plus riche.
Le potentiel de production nationale est pourtant immense. En redynamisant le secteur, nous pourrions produire 34 000 tonnes supplémentaires. Cependant, le manque de diversification variétale reste un obstacle majeur : en France, nous cultivons une seule variété de lentille verte depuis plus de 50 ans et il existe très peu de solutions techniques. Cela place de nombreux agriculteurs dans une impasse après quelques années de culture. En plus, les prix canadiens sont plus compétitifs, et la transparence sur l’origine des produits en magasin fait défaut. Si la demande augmente, la France doit encore relever le défi d’une production locale à la hauteur des attentes et capable de rivaliser mondialement.

Crédit Photo : Léa CRESPI - Madame Figaro
Quelles seraient, selon toi, les priorités à adopter pour garantir que la production de légumineuses contribue durablement à la sécurité alimentaire ?
Pour relancer la production de légumineuses en France, la clé réside dans le développement des volumes et la compétitivité. Le constat est simple : pour rivaliser avec les importations, il faut des solutions techniques innovantes, pas forcément chimiques, mais efficaces.
Cette année, nous avons mené des essais pour repousser les limites de la production. Traditionnellement, les semis de lentilles se font en février-mars, mais nous avons tenté un pari audacieux en les semant dès octobre.
’objectif ? Explorer de nouvelles pratiques agricoles pour optimiser les rendements et adapter la culture aux conditions climatiques.
Pour être compétitif, il est essentiel de multiplier ce type d'initiatives, de développer des solutions adaptées aux agriculteurs français. C’est ainsi que nous pourrons non seulement augmenter les volumes, mais aussi reprendre des parts de marché face aux importations massives, en augmentant progressivement les surfaces cultivées.
Comment les restaurateurs et les consommateurs peuvent-ils, selon toi, soutenir encore davantage la transition vers une alimentation plus locale, durable, et résiliente ?
La transition vers une alimentation plus locale, durable et résiliente nécessite la mobilisation de tous les acteurs. Les restaurateurs, en particulier, jouent un rôle central dans ce changement en introduisant de nouveaux produits dans les habitudes alimentaires. Les restaurateurs initient les consommateurs à ces alternatives plus durables comme les légumineuses. Alors, pourquoi ne pas aller encore plus loin ? Moins de riz, de pâtes ou de pommes de terre comme accompagnement, et davantage de légumineuses, riches en nutriments et moins gourmandes en ressources. Et pourquoi pas comme certains, mentionner les producteurs locaux pour faire le lien entre le consommateur et le terroir.
Mais la clé de la réussite réside dans une collaboration collective. Le consommateur seul ne peut pas y arriver, pas plus que le restaurateur ou l'industriel. Il est nécessaire que chacun fasse sa part pour que cette dynamique prenne de l'ampleur. Et les exemples de filières déjà en place montrent que cela fonctionne. Pourquoi ne pas étendre ce modèle à plus grande échelle ?














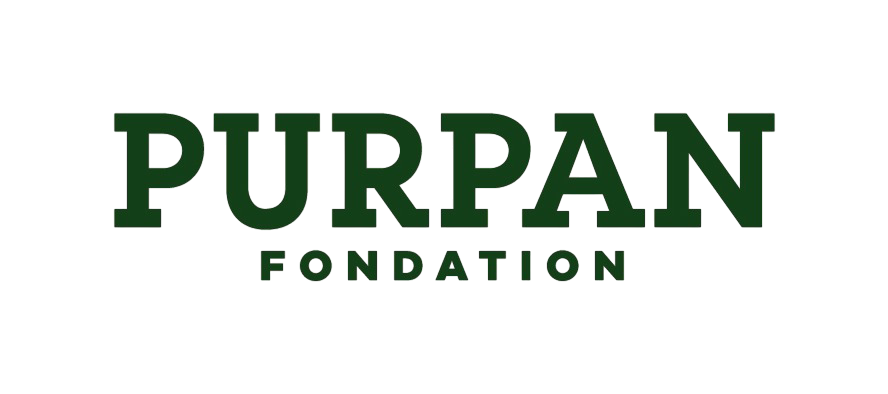
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.